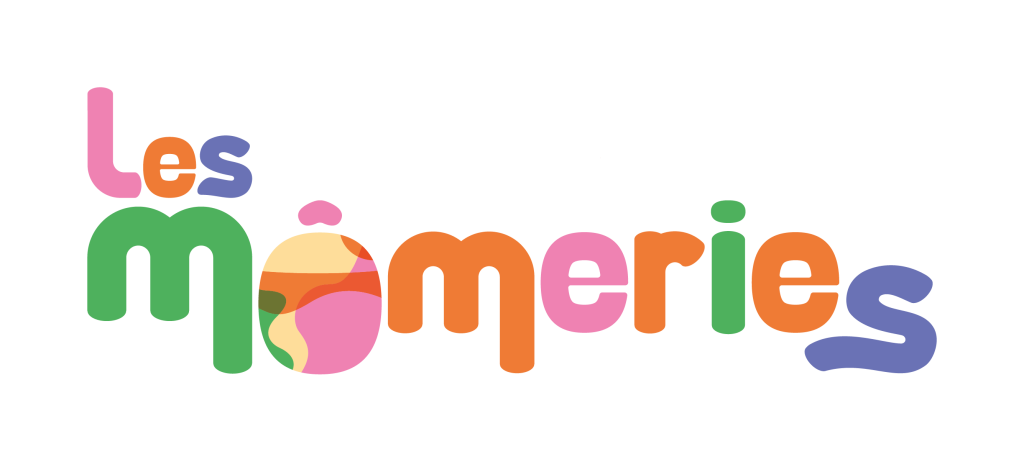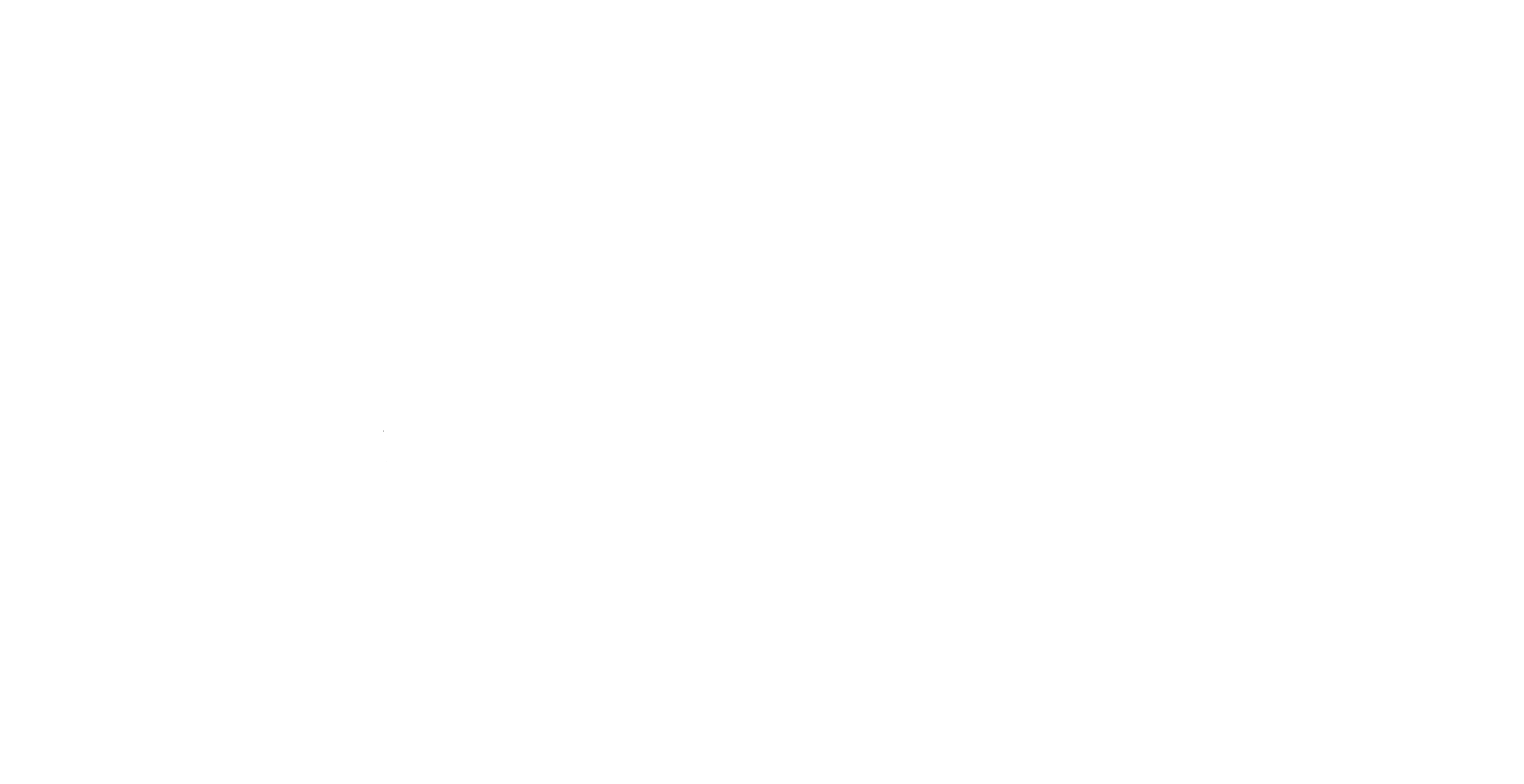Dans de nombreuses structures petite enfance, la mise à jour du projet pédagogique reste perçue comme une contrainte. La direction ou l’équipe d’EJE l’écrivent seules.
Le résultat ? Un document souvent déconnecté du terrain.
Construire ce projet en équipe change radicalement la donne. Voici pourquoi.
1. Rédiger seul, une fausse bonne idée
Rédiger un projet pédagogique seul peut sembler plus rapide. On s’enferme quelques heures pour “cocher la case”.
Mais ce gain de temps est illusoire. Un document écrit en solo est difficile à faire vivre. Il est peu compris, peu appliqué. Le temps “gagné” devient du temps “perdu” en appropriation.La diffusion et l’adhésion ne suivent pas.
Les travaux de John Kotter (1996) l’ont démontré : sans implication collective, il n’y a pas de véritable transformation. Un projet doit être co-construit pour être partagé.
2. Un projet écrit… mais ignoré par l’équipe
Un autre écueil majeur de la rédaction solitaire est la déconnexion entre le projet et la réalité du terrain. Quand les professionnelles ne participent pas à sa construction, elles ont peu de chances de se sentir concernées par son contenu. Ce projet, pourtant fondamental, devient alors un document “officiel” mais désincarné, qui reste dans un tiroir ou un classeur sans jamais guider les pratiques quotidiennes.
À l’inverse, lorsque l’équipe est invitée à réfléchir collectivement aux valeurs, aux objectifs et aux actions concrètes du projet, celui-ci devient un outil vivant, compris et revendiqué. Il prend alors pleinement son rôle de boussole éducative, à laquelle les professionnelles peuvent se référer pour orienter leurs choix, résoudre des dilemmes ou se positionner face aux familles.
3. La surcharge mentale… et émotionnelle de la direction
Porter seule la rédaction d’un projet pédagogique, c’est aussi endosser une lourde charge mentale. Cela suppose de traduire en mots les pratiques de terrain, de formuler des intentions pédagogiques cohérentes avec la réalité, et de s’assurer que tout soit aligné avec les référentiels attendus (CAF, PMI, Charte, etc.). Cet exercice, exigeant sur le fond comme sur la forme, peut vite devenir épuisant — surtout lorsqu’il est mené en parallèle de toutes les autres missions de pilotage.
Or, cette surcharge pourrait être évitée en s’appuyant sur l’intelligence collective de l’équipe. Chaque professionnel·le détient une part précieuse d’expertise, issue de son expérience quotidienne. Mobiliser ces savoirs permet non seulement de nourrir le projet, mais aussi de soulager la direction d’un travail qu’elle ne devrait pas porter seule.
| Démarrer dès maintenant : les 4 grandes questions à poser à son équipe pour enclencher la réflexion |
Avant propos : Pourquoi commencer maintenant ?
Anticiper la construction du projet pédagogique c’est poser les fondations d’un projet d’équipe. Et pour cela, la fin d’année est un moment-clé. Trop souvent, la rentrée de septembre se transforme en sprint : nouveaux enfants, nouvelles familles, ajustements organisationnels… Le temps manque pour ouvrir de vraies réflexions collectives. À l’inverse, les mois d’été offrent une fenêtre idéale : les équipes sont stabilisées, les relations installées, la fatigue est là mais le recul aussi. Surtout, c’est une période où l’on peut penser l’avenir sans l’urgence de l’action immédiate.
Les recherches en dynamique d’équipe et en changement organisationnel (Lewin, 1951 ; Fullan, 2007) montrent que toute transformation efficace commence par une phase d’exploration collective. Cela signifie interroger le réel, ouvrir des espaces de dialogue, permettre à chacun de se sentir concerné. En juin, l’équipe a vécu une année complète, avec ses réussites, ses tensions, ses routines — et elle est donc en position de faire un retour réflexif riche et pertinent.
Amorcer une réflexion en juin, c’est donc respecter le rythme de chacun, nourrir un vrai sentiment d’appartenance au projet et enclencher une appropriation progressive, qui portera ses fruits à la rentrée.
Quelles valeurs éducatives voulons-nous vraiment porter aujourd’hui ?
Cette question n’a rien d’anodin. Beaucoup de projets affichent des valeurs « consensus » (respect, bienveillance, autonomie…), mais celles-ci méritent d’être rediscutées à la lumière du vécu de l’année. Qu’est-ce que la bienveillance implique au quotidien ? Quelles tensions ou contradictions avons-nous rencontrées ? Cette réflexion peut partir de situations concrètes, d’exemples vécus, pour redonner du sens aux mots.
Quelles pratiques mériteraient d’évoluer ?
On peut ici interroger les routines, les postures professionnelles, les temps forts de la journée. Y a-t-il des pratiques qui ne « collent » plus à ce que nous voulons transmettre ? Des zones de flou ? Des changements que l’équipe aimerait expérimenter ? On peut s’appuyer sur des outils simples, comme une cartographie des temps de la journée, ou une météo des pratiques, pour enclencher cette discussion.
Quelle place voulons-nous donner aux familles ?
La coéducation reste une ambition forte, mais sa mise en œuvre est souvent délicate. Post-Covid, les liens se sont transformés. Les attentes des familles aussi. Il est utile de se demander : quels espaces avons-nous ouverts (ou fermés) cette année ? Comment permettre une relation plus horizontale, dans le respect des rôles de chacun ? Cette question est d’autant plus importante qu’elle engage la posture professionnelle et la qualité du climat relationnel au sein de la structure.
Quels sont les enjeux émergents auxquels nous devons répondre ensemble ?
Les structures font face à des réalités mouvantes : augmentation des besoins spécifiques, nouvelles attentes institutionnelles, évolutions sociétales (rapport à l’autorité, à l’émotion, à la diversité…). Inviter l’équipe à identifier ces enjeux, c’est reconnaître son expertise de terrain, et lui permettre de se positionner comme actrice de l’évolution du projet.
Un projet pédagogique utile = un projet qui vit (et qui se relit toute l’année)
Trop souvent, le projet pédagogique devient un document figé, rangé dans un classeur, mobilisé uniquement en cas d’inspection ou pour les besoins administratifs. C’est oublier que ce projet, censé incarner les valeurs, les choix éducatifs et les pratiques d’une équipe, ne peut être utile que s’il reste vivant.
Or un texte n’est pas vivant par nature : il le devient par l’usage qu’on en fait, par les rituels qu’on crée autour de lui, et par les personnes qui s’en emparent.
Comment faire vivre le projet au quotidien ?
Un projet pédagogique utile n’est pas celui qu’on connaît par cœur, mais celui qu’on relie à l’action.
- Le relire ensemble régulièrement, lors de réunions d’équipe ou de temps de régulation : relire un extrait, le commenter à la lumière d’une situation récente vécue dans la structure, questionner sa pertinence aujourd’hui.
- L’utiliser comme base d’analyse de pratique : par exemple, quand une situation interroge (violence entre enfants, accueil des familles en difficulté, gestion d’un conflit…), revenir au projet et se demander : “qu’est-ce que nos principes pédagogiques disent de ça ?”.
- S’en servir dans les entretiens annuels ou les bilans professionnels : les valeurs du projet peuvent guider l’échange sur la posture, les compétences, les évolutions.
- L’introduire dans le parcours d’intégration des nouvelles recrues : plutôt que de leur remettre le projet comme une brochure, organiser un temps d’échange autour de ses principes fondateurs, en demandant : “Qu’est-ce qui vous parle ? Qu’est-ce qui vous interroge ?”.
- Faire vivre sa dimension évolutive : chaque année, à une date fixe, ouvrir une boucle de rétroaction collective (réunion d’équipe, questionnaire, boîte à idées) pour identifier les points du projet qui mériteraient d’être actualisés, précisés ou reformulés.
Cette logique de réactivation régulière transforme le projet en outil réflexif et fédérateur. Il devient un repère dans les moments de doute, un levier pour renforcer l’identité d’équipe, et un support pour harmoniser les pratiques. Il aide à poser des choix partagés, à sortir des interprétations individuelles, et à reconstruire du sens commun là où les tensions ou les malentendus brouillent la relation entre professionnels.
Des exemples inspirants qu’on a observés chez vous…
- Une micro-crèche associative organise chaque trimestre une “pause-projet” : 30 minutes dédiées à relire un extrait du projet à la lumière de ce que l’équipe vit actuellement, et à produire une micro-évolution si nécessaire.
- Un accueil périscolaire municipal a intégré le projet pédagogique dans le carnet d’accueil des nouveaux animateurs, avec un quiz virtuel et amusant pour se l’approprier et un temps de discussion animé par la direction.
- Une crèche hospitalière utilise son projet comme grille d’auto-évaluation collective, avec des ateliers où chaque professionnel coche, commente et enrichit les points du projet à partir de ses observations du terrain.
- Une école maternelle associative organise chaque fin d’année une “fête du projet” où les familles sont invitées à découvrir les valeurs et pratiques clés à travers des jeux, photos, et mini-ateliers animés par les pros.